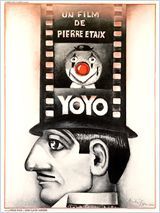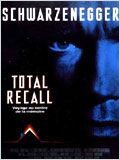Le "fil ciné de Phil Siné", c'est la synthèse mensuelle des films que je vois au cinéma, en DVD, à la TV ou par le biais de tout autre moyen ou support... Il s'agit ainsi de dresser un bilan très
personnel et subjectif, un "vade mecum" récapitulatif et synthétique de ma "cinémathèque virtuelle", afin de pouvoir la parcourir d'un seul regard ! Les films y sont classés par niveau
d'appréciation, ce qui permet de repérer leur intérêt en un clin d'oeil. Un lien vers la chronique critique des films est fait lorsque celle-ci existe sur le blog et un avis succinct est parfois
proposé pour les autres films...



En avril 2010, Phil Siné a vu 36 films au total. 30 ont été vu au cinéma, parmi lesquels 23 films sortis en 2010 (surlignés en rouge). Parmi les 36 films, 11 sont français et 14 sont
américains.




Les chaussons rouges, de Michael Powell
et Emeric Pressburger (Grande-Bretagne, 1948)
Daniel & Ana, de Michel Franco
(Mexique, 2010)
Morse : Let the right one in, de Tomas Alfredson (Suède,
2009)
New York, New York, de Martin Scorsese (Etats-Unis,
1977)



Hedwig and the angry inch, de John Cameron Mitchell
(Etats-Unis, 2001)
Lifeboat, d’Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1943)
London Nights, d’Alexis
Dos Santos (Grande-Bretagne, 2010)
Mammuth, de
Gustave Kervern et Benoît Delépine (France-Groland, 2010)
Les raisins de la colère, de John Ford (Etats-Unis, 1940)
> Un sublime hommage au prolétariat et aux masses laborieuses de tout temps ! Fable
cruelle et implacable sur l'exploitation éternelle de l'homme par l'homme, sur fond de chronique familiale déchirante... Inoubliable !


Les arrivants, de Claudine Bories et Patrice Chagnard (France, 2010)
> Un documentaire passionnant sur la CAFDA, qui essaie d’aider les demandeurs d’asiles qui arrivent à Paris. On assiste à la difficulté des assistantes sociales
pour gérer des familles complètement démunies. Leur travail s’avère souvent décourageant et vain, et une forte implication physique et psychique les mène souvent au bord des larmes… Heureusement,
des scènes souvent très humaines, parfois drôles, viennent tempérer la tragique réalité !
Domaine, de Patric Chiha (France-Autriche,
2010)
L’épine dans le cœur, de Michel Gondry (France,
2010)
Huit fois debout, de Xabi Molia (France, 2010)
Les invités de mon père, d’Anne Le Ny (France, 2010)
Kick-Ass, de Matthew Vaughn (Grande-Bretagne, Etats-Unis,
2010)
Lignes de front, de
Jean-Christophe Klotz (France, 2010)
Nuits d’ivresse printanière, de
Lou Ye (Chine, 2010)
The Rocky Horror picture show, de Jim Sharman (Etats-Unis,
1975)
Stalker, d’Andreï Tarkovski (Russie, 1979)

Ajami, de Scandar Copti et Yaron Shani (Israël-Palestine, 2010)
> Si un film réalisé à quatre mains par un Juif et un Palestinien fait rudement plaisir à voir, l’aspect un peu brouillon et peu rigoureux de la mise en scène
rend le film parfois flou ou ennuyeux… Les méthodes de tournage, notamment l’utilisation de comédiens non-professionnels vivant à Ajami, confèrent au long métrage une texture documentaire
intéressante et souvent troublante.
La comtesse, de Julie Delpy (France, 2010)
> Julie Delpy surprend avec cette évocation de la comtesse Bathory, entre drame romantique et fable sur les ravages du temps, à tendance horrifique... Nul excès
cependant dans le mise en scène, souvent d'une sobriété glaçante, et beaucoup de finesse font de cette oeuvre une splendide curiosité !
Hana-Bi (Feux d'artifice), de Takeshi Kitano (Japon, 1997)
> Un style fort et des images poétiques, ponctuées de furieux instants de violence ou de quelques moments d'humour décalé. On a cependant du mal à rentrer
pleinement dans l'intrigue...
Jarhead, la fin de l'innocence, de Sam Mendes (Etats-Unis, 2005)
> Un très beau manifeste anti-guerre, depuis les premières classes d’un soldat jusqu’à son expérience du terrain et son retour à la civilisation, l’âme pour
toujours marquée par ce voyage au bout de l’enfer… Pertinente et impressionnante évocation de la première Guerre du Golfe, le film souffre cependant de la comparaison aux chef-d’œuvres qui l’ont
précédé, signés Kubrick ou Coppola.
Lenny and the kids (Go get some Rosemary), de Joshua &
Benny Safdie (Etats-Unis, 2010)
Le mariage à trois, de Jacques
Doillon (France, 2010)
New York, I love you (Etats-Unis,
2010)


Les
aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec, de Luc Besson (France, 2010)
Ensemble, nous allons vivre une très, très grande histoire d’amour, de Pascal Thomas (France, 2010)
Green Zone, de Paul Greengrass (Etats-Unis-Grande-Bretagne, 2010)
> Un film anglophone qui s’essaie à dénoncer les manipulations et les mensonges de l’administration Bush à l’époque de son entrée en guerre contre l’Iraq de
Saddam Hussein, ça fait quand même rudement du bien… Dommage que le style du film, « efficace » et « bourrin », ne suffit pas à en faire une œuvre véritablement politique !
Snake Eyes, de Brian De Palma (Etats-Unis, 1998)
> Un bel exercice de style, basé sur le pouvoir des images et leur mystification. Peut-être un peu trop "technique" et pas assez "sensible"...
Téhéran, de Nader T. Homayoun (Iran, 2010)
> Une sombre histoire de trafic de bébés, tournée clandestinement à Téhéran. La mise en scène, nerveuse et sauvage, plutôt efficace, rend compte de cette dimension d’images volées, comme
furtives…

The Game, de David Fincher (Etats-Unis, 1997)
> Un film sans queue ni tête, au scénario dans lequel le "héros" est mené en bateau, embarquant avec lui le spectateur dans un "jeu" absurde et vain, duquel naît
très vite un abyssal ennui... Beaucoup de moyens, peu d'effets !
Greenberg, de Noah Baumbach (Etats-Unis, 2010)
> Un film complètement neurasthénique sur la neurasthénie d'un homme et de son chien : malgré quelques bonnes blagues, une telle confusion du fond et de la forme
s'avère bien trop éprouvant pour ne pas s'ennuyer ferme !
Henry, de Kafka et Pascal Rémy (France, 2010)
> Un film plutôt médiocre dans son ensemble, notamment à cause d'un scénario pauvre et mal construit. On éprouve quand même un certain plaisir à revoir Elise
Larnicol et "Kafka", dans le rôle d'un méchant cynique assez proche de son personnage de Francis Kuntz, le journaliste le plus répugnant et vénal du Groland !

Le choc des Titans 2D,
de Louis Leterrier (Etats-Unis, 2010)
L'histoire sans fin 3 : Retour à Fantasia, de Peter MacDonald (Etats-Unis, 1995)
> Le pire épisode de la saga, d'une laideur absolue et d'un ridicule monumental, à mille lieues de l'univers subtil, magique et poétique du roman de Michael
Ende...